Souvenir
Nous sommes en 2004, fin mars, mais je vois devant moi cette scène d’arrivée à la gare de Budapest comme si s’était hier et non pas en mars 1944, il y a soixante ans.
C’était une nuit sombre et menaçante, illuminée seulement de temps en temps par les lampes de poche puissants des SS. Le silence régnait, interrompu de temps en temps par l’aboiement des chiens tenus en laisse ou ceux des officiers allemands aboyant des ordres ou posant des questions.
Le train arrivant de Transylvanie s’était déjà vidé. Nous ne le savions pas encore, mais c’était le dernier train parti de Kolozsvàr, ma ville natale, sans contrôle au départ. Ensuite, on ne permettait plus à aucun juif d’y monter.
Nous étions seuls, isolés dans le temps et empêchés de sortir de la gare.
En fait, on nous obligea à rester près de la porte de sortie du wagon d’où nous avions descendu. Maman me serrait fort la main et moi, obéissante à ce qu’elle m’avait dit, me taisais.
Me taire m’était difficile, de nature j’étais (je suis encore) bavarde. Ouverte. Mais l’ombre des gens qu’on éloigna au loin, qu’on n’avait pas laissé sortir de la gare, la main de maman tremblant sous une apparence de calme et fermeté de voix, les chiens et les hommes en uniforme aboyant, me glaça.
Je ne savais pas pourtant.
Je ne savais pas qu’à cet instant mon existence se jouait : survivrai-je jusqu’au lendemain ? Vivrai-je encore dans une mois ?
Ces quelques minutes de silence glacées me donnèrent encore soixante ans de vie. J’ai dû être toute blanche. Je ne savais pas pourtant.
Je ne savais rien de la terreur nazie dans le monde, ni des persécution des juifs. Je ne savais même pas que j’en étais une : ma mère m’avait déclaré cinq ans avant : « tu es Calviniste » et je suivais les classes du pasteur, je fêtais Noël, pendant que ma cousine Magdie, de même âge que moi, était emmenée par sa mère, sœur aînée de papa, au rabbinat et mes cousins côté maman fêtaient Hanoukka. Mon arrière-grand-mère Paula mangeait cacher, mes grands-parents n’étaient plus religieux même si grand-mère Sidonie allumait chaque vendredi soir des bougies.
"C’est au souvenir des morts, Julika", me dit-elle une fois et elle commença à les nommer. A l’époque il n’y avait plus de sept encore.
Je ne savais pas non plus que vingt-quatre heures seulement avant, les troupes allemandes ont envahi le territoire de Hongrie, pourtant « ami », auquel la Transylvanie, et Kolozsvàr, sa capitale, faisait partie (aujourd’hui devenu Cluj). Je ne savais pas non plus qu’ils sont venus pour mettre fin à la neutralité du gouvernement hongrois, empêcher le départ de ce pays de l’alliance et, surtout, mettre fin d’urgence à l’attitude trop bienveillant à leur goût de ce dernier envers les juifs.
Les juifs étaient en Hongrie, jusqu’à ce soir-là, des citoyens hongrois à part entier. La plupart entre eux complètement intégré et grand patriotes, non religieux.
Mon grand-père Emil avait lutté en 1915 dans l’armée Austro-Hongrois comme lieutenant des Ponts et Chaussés et revenu blessé à vie, fier toutefois d’avoir fait son devoir. Mon arrière arrière-grand-père maternel, père de Paula, avait reçu de l’ Empereur, à la place de titre de baron, qu’il refusa, un tuteur, l’ancien tuteur des enfants de la maison royale de Vienne. Ce tuteur enseigna dans leur domaine les nombreux fils des treize enfants et aussi Paula, curieuse, la plus petite entre eux. Mon arrière arrière-grand-père se considérait tout à fait hongrois, même si son grand-père banquier David Hirsch était arrivé en Transylvanie en venant de la France, Alsace, d’où il a dû s’enfuire avec sa grande famille devant la Terreur qui suivit la Révolution française de 1789.
Nous étions d’abord hongrois, ensuite d’origine juive.
Ou calvinistes, puisque mes parents sont devenus quand j’avais deux ans. Sur papier ou vraiment, je ne le sais pas vraiment.
Je ne savais pas encore, tremblant de fatigue et de froid sur le quai sombre de la gare non illuminée pour la préserver des bombardements anglaises, passant menaçant dans le ciel mais laissant encore rarement tomber leur obus sur la capitale hongrois. Le gouvernement hongrois « faisait semblant d’être allié avec Hitler et les Anglais faisaient semblant de bombarder ce pays » dit un livre d’histoire lu récemment.
Jusqu’à ce jour-là, le gouvernement hongrois faisait aussi semblant à s’occuper du « problème juif » dans leur pays. Pendant qu’en France on avait déjà envoyé ce qu’on a attrapé en Allemagne, qu’en Pologne tué ou déporté, mis en ghetto, tous liquidés, nous vivions, continuions nos vies comme si rien n’était. Ou presque.
Comme les Français avant la guerre, allant en vacances ne se doutant pas, ne croyant pas ce qui s’abattra sur eux.
J’ai survécu, parce que mes parents ont douté.
J’ai survécu, parce que maman était déterminée ce soir-là, auparavant et plusieurs fois elle eut le bon instinct encore. J’ai survécu, parce que papa était adroit, rusé et prévenu et un copain allemand lui avait donné des bons conseils. J’ai survécu, parce que je n’ai pas ouvert la bouche cette nuit-là même pour dire mon nom.
Magdie, mes grands-parents paternelles, presque tous les membres de ma famille restés à Kolozsvàr, deux mois plus tard n’existeront plus. Rassemblés sur le terrain d’ancien usine de briques, bourrés dans des wagons pour bestiaux, envoyés à Auschwitz, la plupart d’eux seront poussés à « faire une douche » et tué au Cyan, gazé, brûlé dans la même nuit.
Magdie n’est pas atteint ses dix ans, j’ai soixante-dix.
Mes parents ont prévenu ce qui pourrait arriver en Hongrie aussi, la mère de Magdie n’y a pas cru. Et elle refusait de nier à être juive ou ne pas inscrire sa fille pour des leçons de religion à la synagogue.
Mon père s’est procuré des papiers d’identité d’une famille à 100% chrétien de son village de naissance, une famille ayant une petite fille presque de même âge que moi.
Il aurait dû venir nous accueillir à la gare.
L’envahissement de Hongrie par les troupes allemandes l’avait surpris à Budapest. A l’époque nous habitions à Kolozsvàr. Il a appelé pendant la nuit et demanda que nous prenions le premier train du matin, sans papiers, il nous attendrait à l’arrivé avec les « bonnes. »
Il ne venait pas et ne venait pas et les SS nous interdisaient à bouger de là avant voir nos papiers. Ces papiers qui étaient avec papa. Cet époux mystique d’après eux qui n’apparaissaient pas.
Je ne comprenais rien. Mon père était toujours là à s’occuper de nous quand il le fallait.
Ma mère serra encore plus fort ma main et son regard me disait « tais-toi ! » Je ne savais pas pourquoi. Elle tremblait, craignant qu’ils aient arrêté mon père et déshabillé et ont vu qu’il était circoncis.
Nous étions peut-être pas trente minutes dans cette gare en attendant qu’un miracle arrive, quand, enfin, mon père paru de loin en agitant nos papiers. Plus tard, il raconta que les soldats ont encerclé la gare ne laissant personne y pénétrer. Finalement, il avait réussi à soudoyer un employé qui l’avait fait entrer. Mais ce soir-là, il ne dit rien. C’était maman qui parlait soudain dans la nuit silencieuse.
- Voici mon mari.
- Vous avez leurs papiers ? demanda l’officier.
Sans paroles, mon père tendit les papiers.
Une fois examinés, l’officier demanda :
- Pourquoi sont-ils chez vous ?
- C’est moi le chef de famille.
Cette réponse paru le satisfaire. On nous laissa enfin sortir de la gare. Après ce silence menaçant, libérés et éloignés des chiens et officiers aboyant, j’avais envie de parler. Papa nous a mis dans un taxi et je commençai aussitôt à l’interroger.
- Papa, pourquoi…
- Chut. Il est tard. Ferme les yeux et tais-toi.
Je ne savais pas encore qu’à ce moment-là j’ai cessé d’être Julika Kertész et avoir dix ans, que mes parents jusqu’à la fin de la guerre ne s’appelleront plus Katinka et Pista. A partir de là, nous allons vivre une année avec d’autres noms et prendre d’autres rôles. Au lieu des citadins, nous sommes devenus des « paysans réfugiés fuyant les Russes s’approchant de la Transylvanie. »
Le lendemain, loin des oreilles des inconnus, on m’explique le changement de nom.
- Pourquoi ? Nous ne sommes pas juifs.
- D’après les nouveaux décrets, tout le monde ayant au moins des grands-parents juif est considéré juif. Baptisés ou non, cela ne compte plus. Et tes grands-parents…
- Je sais. Oui. Eux, ils le sont.
- Tu t’appelleras donc Pirike et tu as onze ans dorénavant.
- Onze ?
C’était gagné. Je n’avais pas encore dix ans et j’étais ravie d’avoir subitement une année de plus. Tout me paraissait un jeux.
Je laissais derrière moi le souvenir lourd et rempli de menaces ressentis plus vagues encore que conscients et seulement une année plus tard, j’apprenais, à notre retour à Kolozsvàr, à ce que j’ai échappé. A partir de ce moment j’ai porté sur le cou une chaînette : on ne me prendra pas toute nue dans la douche comme ma cousine, alors je vivrais.
Cette chaînette ne quitta plus mon cou jusqu’à un autre départ, quand j’ai échappé encore avec ma vie sans même comprendre de nouveau vraiment la menace pesant sur moi. Mais cela, je le raconte vers la fin de ce volume, il se passera presque vingt ans plus tard. Et de nouveau, je devrais me taire pour survivre. Me taire longtemps. Maman m’a apprit à être « invisible » et sans me rendre compte cela resta en moi fort longtemps après.
Quelques mois plus tard de notre arrivé à Budapest, nous voilà cachés dans une cave. Menacés pas seulement de découverte par les SS allemands et hongrois de notre véritable identité, mais aussi des obus russes. Nous étions nombreux dans cette cave, vivant tout près les uns des autres et personne de cette villa ne savaient rien de nous.
Pour m’aider à rester silencieuse, maman m’offrit mon premier journal. Je le laisse parler avec ma voix de dix ans, cachant, même là, nos vrais identités. Je n’y ai pas mise nos noms véritables ni l’angoisse décrit qu’en cette phrase anodine après une forte pluie d’obus « et personne n’est mort. » Ce que je voulais croire.
Dans la suite de mon journal, après notre arrivé à Kolozsvàr, dorénavant Cluj, Roumanie et non plus Hongrie, nous avons retrouvé, après une année entière de départ, vécus cachés, notre ancienne appartement et la plupart des meubles aussi. Même mon arrière grand-mère, qui a survécu par miracle! Mais nous n'avons pas retrouvé la famille de mon père. Ses parents, ont été emportés à Auschwitz, et sa soeur aussi avec sa fille, Magdi, de mon âge.
Magdi avait été ma camarade de jeux depuis ma naissance presque et ma camarade de classe depuis nos six ans. Ma seule amie aussi. Je n'arrivais pas à croire qu'elle a disparu à jamais, et j'attendais, espérais, longtemps, qu'elle reviendra.
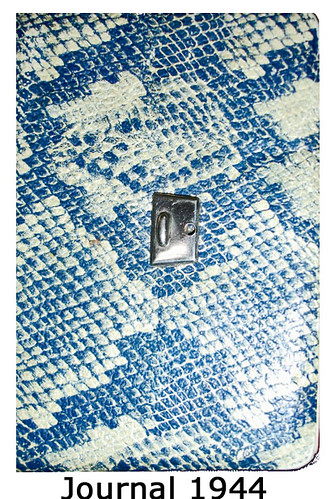

 Pages journaux : alors et maintenant. Finalement, mon écriture n'a pas changé tant que cela de 1944 jusque 2005!
Pages journaux : alors et maintenant. Finalement, mon écriture n'a pas changé tant que cela de 1944 jusque 2005!

